La guerre en effet qui finit par abattre Athènes (en 405, après la bataille d'Aigos-Potamos) naquit de l'Empire, acceptée par Périclès comme par Sparte, qui y voyait comme un moyen de donner à juger aux dieux et aux hommes de la valeur de leurs institutions.
En 441, Samos avait eu l'audace de s'attaquer à Milet, la patrie d'Aspasie. Périclès, après avoir voulu imposer un arbitrage diplomatique entre les deux cités, avait envoyé quarante vaisseaux qui prirent la ville; les alliés, qui en avaient profité pour se détacher d'Athènes, furent, eux aussi, soumis. En 433, Athènes ordonna à Potidée de raser ses murailles : la cité, colonie de Corinthe, fit appel à la métropole et fonda avec les autres cités de Chalcidique une ligue qui se dressa contre Athènes (Potidée résista jusqu'en 429 aux assauts des troupes athéniennes). Ce fut lorsque Périclès ordonna de fermer aux navires de Mégare, ville de l'Isthme favorable à Sparte, l'ensemble des ports de l'Empire et les marchés d'Athènes que les Spartiates et leurs alliés péloponnésiens se décidèrent à en découdre (poussés par Corinthe, qui songeait au sort de sa colonie de Thrace).
Les Péloponnésiens envisageaient une victoire rapide, confiants en la valeur traditionnelle de leur infanterie; d'ailleurs, l'état de leurs finances leur interdisait en principe de prolonger les hostilités. Périclès, lui, devait envisager autrement le déroulement de la guerre : il lui fallait compter avec la médiocrité éventuelle du soldat-citoyen et avec sa clientèle populaire dans une cité où l'hoplite n'était pas nécessairement un partisan de sa démocratie; sa situation s'était quelque peu détériorée (son autorité s'affaiblissait de ses quinze ans de pouvoir ininterrompu), puisque depuis le retour de Thucydide (433) s'étaient reconstitués les clubs d'aristocrates (hétairies) et que l'on intentait des procès à ses familiers en espérant l'atteindre (à Phidias, à Anaxagore, à Aspasie elle-même).
Il fit se replier toute la cité sous la protection des Longs Murs; l'Attique
fut abandonnée à l'ennemi. Ce fut à la flotte que revint la charge de nourrir la cité, d'inquiéter l'adversaire en harcelant ses côtes. Les risques d'une telle stratégie étaient grands : on pouvait craindre de voir la cité se démoraliser à veiller, inutile, aux remparts, tandis que l'ennemi brûlait récoltes et villages, mais surtout, à long terme, on provoquait la destruction de la classe des petits propriétaires fonciers qui, depuis l'époque de Pisistrate, avaient fait la puissance, la santé et l'équilibre d'Athènes. Périclès espérait pouvoir, par sa présence, garantir le moral des citoyens, par la victoire enrichir assez Athènes pour que ses pertes ne lui fussent rien.
La première année de guerre parut lui donner raison : les Spartiates et leurs alliés envahirent l'Attique, mais purent se retirer sans avoir pu combattre, Périclès ayant refusé une sortie de l'armée athénienne. En revanche, la flotte sema la terreur le long des côtes péloponnésiennes et des garnisons s'installèrent sur les sites stratégiques (Egine). La puissance de l'Empire, l'invulnérabilité de la flotte semblaient promettre une victoire facile; Périclès disait sa confiance aux citoyens rassemblés pour l'éloge aux morts à la fin de la campagne.
L'année 430 vit arriver, par un vaisseau d'Egypte, la peste qui, dans la ville surpeuplée, fit des ravages (un tiers de la population d'Athènes périt). Le peuple vit en Périclès le responsable de ses souffrances; il fut déposé, il lui fallut rendre des comptes sur ses quinze années de pouvoir et il ne put justifier l'emploi de tous ses fonds secrets. Le tribunal populaire le condamna à une amende de cinquante talents. Pourtant, sa disgrâce n'apportait nul soulagement, les défaites s'accumulèrent.
Dans la cité affaiblie, il restait l'homme nécessaire : au printemps de 429, il fut réélu stratège. Durant l'été, il eut la joie de voir la flotte athénienne remporter les victoires de Potidée et Naupacte. Ses deux fils étaient morts et il était lui-même usé par les charges qu'il avait assumées; il mourut en septembre.
«Tout le temps qu'il fut à la tête de la cité pendant la paix, il la dirigeait avec modération et sut veiller sur elle de façon sûre... et de même, lorsqu'il y eut la guerre, il apparaît que là aussi il apprécia d'emblée sa puissance. » Thucydide, II, 65-5
Mais nul ne pouvait assurer sa succession; ce grand homme trop puissant semblait avoir fait autour de lui le vide.
ASPASIE.
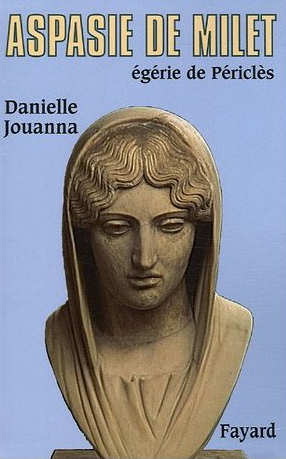
Aspasie de Milet
Périclès s'était marié tard (v. 457 av. J.-C.) à une femme d'une excellente famille. Elle lui donna deux fils (Xanthippos et Paralos), mais elle ne sut pas (élevée comme toutes les Athéniennes dans la médiocrité et l'insignifiance du gynécée) être la compagne dont il avait besoin : ils se séparèrent et Périclès rencontra l'amour à quarante-trois ans.
Aspasie était une Grecque de Milet venue vers 450 à Athènes, où son compatriote Hippodamos de Milet, l'architecte sociologue, l'avait mise en rapport avec lui. Elle resta vingt ans à ses côtés.
C'était une femme supérieure, une femme d'esprit avec laquelle Périclès avait plaisir à s'entretenir des affaires publiques; douée d'une grande culture, elle savait les règles du discours, et Socrate faisait cas de sa conversation. Elle savait recevoir et à son cercle se pressaient Sophocle, le sculpteur Phidias, les architectes Ictinos, Callicratès, Hippodamos, qui la connaissait de longue date : elle offrait ainsi à Périclès le charme d'une maison qui était pour lui un véritable foyer, où régnait l'amitié des plus grands artistes et penseurs du temps.
Cette union qui fut si tendre (chaque jour, Périclès, partant pour l'agora, ne manquait pas, dit Plutarque, d'embrasser sa femme, ce qu'il faisait aussi en rentrant chez lui) ne fut pas sans provoquer dans l'opinion un très vif mécontentement : les Athéniens, peu favorables à l'émancipation des femmes, les poètes comiques toujours prêts à exploiter une veine satirique la couvrirent de boue, mais Périclès sut toujours la défendre avec une grande dignité; ainsi en 432, où elle fit l'objet d'une accusation en règle devant le tribunal. D'ailleurs, le peuple lui rendit finalement justice : quand les deux fils du premier mariage de Périclès eurent été tués en 429 par l'épidémie de peste, l'assemblée accorda à Périclès la grâce de la citoyenneté pour le fils qu'il avait eu d'Aspasie (depuis la loi de 451 en effet, seul était citoyen celui qui était né de père et mère athéniens). Ce jeune homme, Périclès le jeune, fit d'ailleurs une belle carrière politique et fut stratège en 406 (malheureusement pour lui, ce fut aux Arginuses, où tous les généraux athéniens, malgré leur victoire, furent condamnés à mort).
LES MAITRES A PENSER.
Damon d'abord l'instruisit, qui resta toujours (du moins jusqu'à ce qu'il fût ostracisé en 464) pour lui dans sa vie publique un conseiller sûr. C'était un théoricien de la musique, mais, comme «on ne saurait toucher aux règles de la musique sans ébranler en même temps les lois fondamentales de l'État» (c'est Platon qui, dans la République, où la musique est justement la base de l'éducation, rapporte cette opinion de Damon), il apparut qu'il était «couvert du nom de musicien et hantait autour de Périclès comme un maître... qui lui enseignait comme il devait se conduire dans les affaires d'État» (Plutarque); il aurait inspiré à Périclès l'essentiel de mesures démocratiques, comme par exemple de donner une rétribution à qui s'occupait des affaires de la cité (misthophorie).
Zénon d'Élée vint à Athènes vers le milieu du Ve siècle; «l'homme aux deux langues» qui réussissait à «présenter à ses auditeurs une seule et même chose comme semblable et dissemblable, une et multiple, immobile et en mouvement», l'inventeur, dit Aristote, de la dialectique, arma son intelligence.

Anaxagore et Périclès Augustin-Louis BELLE
© Matthiesen Gallery London
Anaxagore de Clazomènes surtout nourrit son âme. Périclès entretenait avec lui les relations les plus étroites; il apprit ainsi la clarté, la rigueur, il sut mettre au service de la gloire d'Athènes une intelligence éclairée et équilibrée par la confiance que lui inspirait l'élévation de la philosophie. Comme nous le dit Plutarque, «il en prit non seulement une grandeur et hautesse de courage et une dignité de langage où il n'y avait rien d'affecté, de bas, ni de populaire, mais aussi une constance de visage qui ne se mouvait pas facilement à rire, une gravité en son marcher, un ton de voix qui jamais ne se perdait, une contenance rassise [...] qui jamais ne se troublait pour chose quelconque...»; et aussi « il apprit aussi à chasser hors de soi et mettre sous les pieds toute superstitieuse crainte des signes célestes et des impressions qui se forment en l'air, lesquelles apportent grande terreur à ceux qui en ignorent les causes, et à ceux qui craignent les dieux d'une façon éperdue, parce qu'ils n'en ont aucune connaissance certaine que la vraie philosophie naturelle donne, et au lieu d'une tremblante et toujours effrayée superstition, engendre une vraie dévotion accompagnée d'assurée espérance de bien».
Le dernier des maîtres de Périclès n'avait pas eu l'influence la moins agissante.